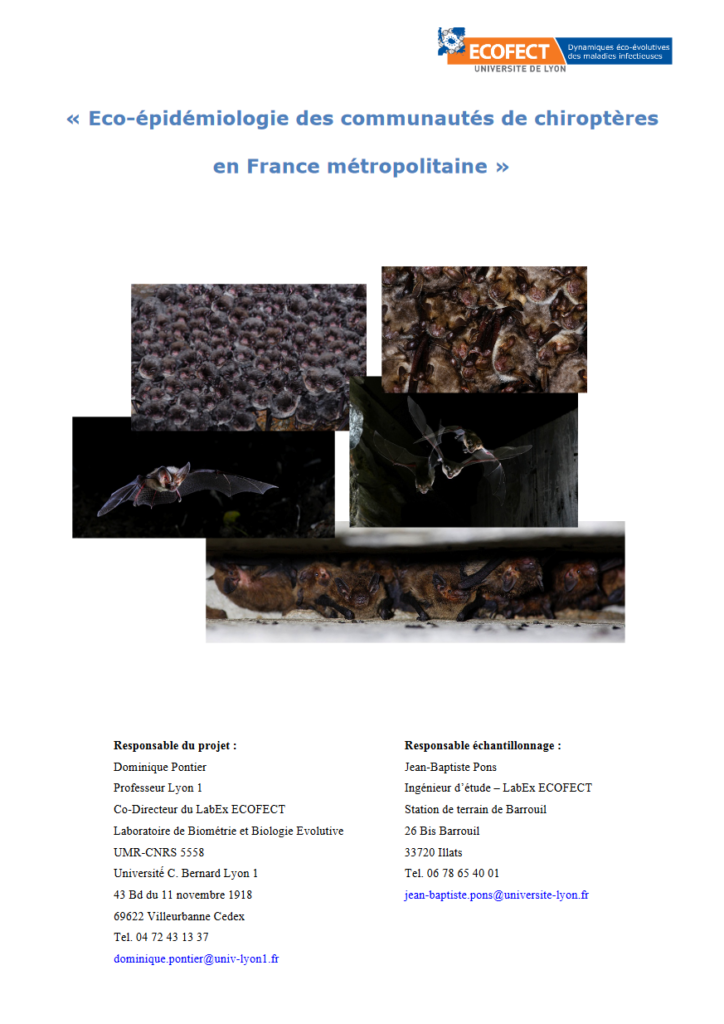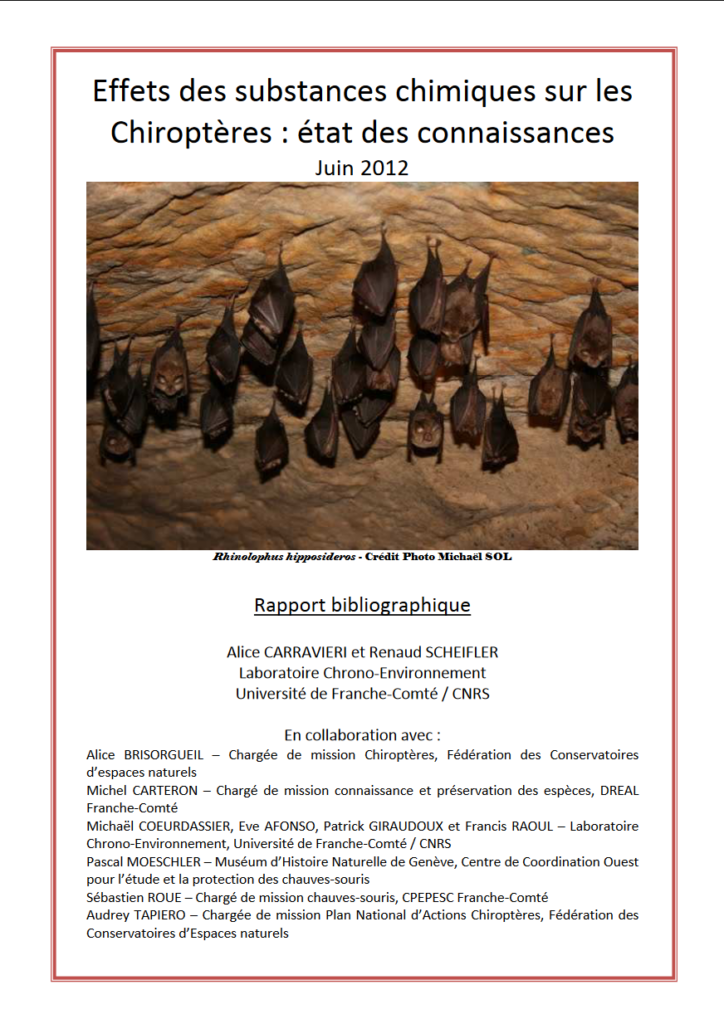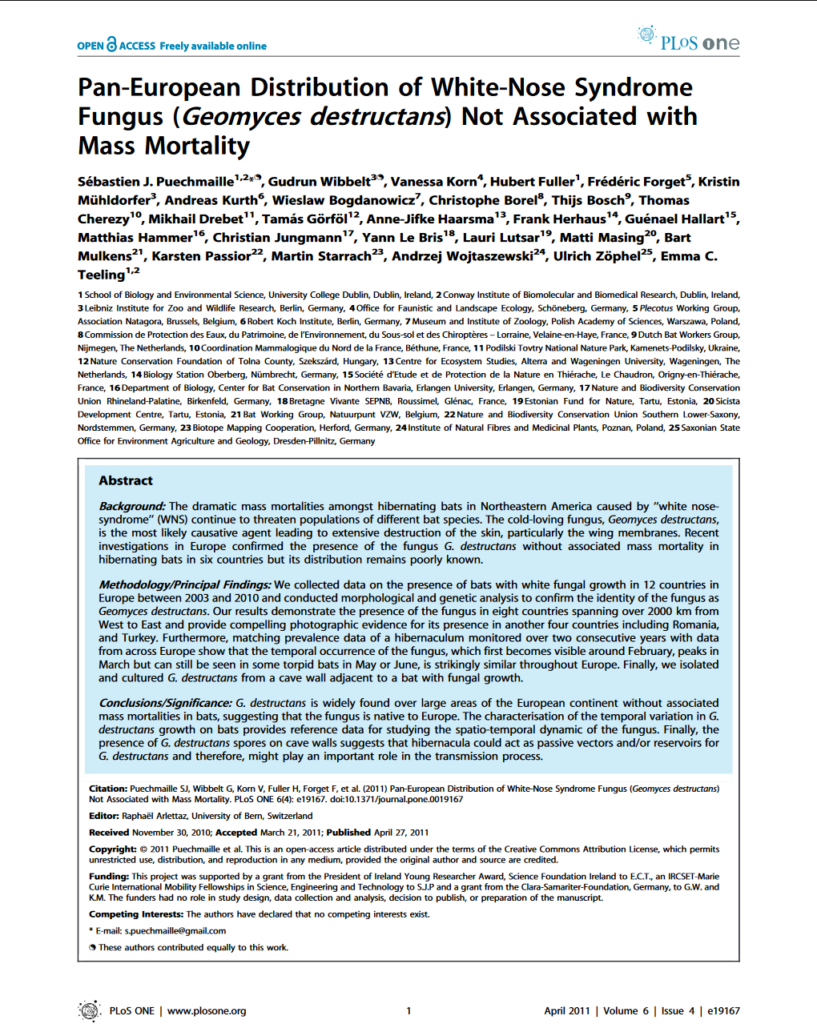Les épizooties, ou épidémies animales, représentent une menace croissante pour les populations de Chiroptères, ces mammifères volants qui jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes. Considérées comme des espèces parapluies, les chauves-souris sont essentielles pour de nombreuses autres espèces patrimoniales, contribuant ainsi à la diversité de la faune et de la flore des écosystèmes qu’elles occupent. Cependant, leur vulnérabilité aux maladies infectieuses en fait des cibles sensibles, ce qui rend leur surveillance et leur gestion particulièrement importantes pour assurer leur préservation.
La surveillance des Chiroptères repose sur un réseau de référents spécialisés capables de réagir rapidement en cas de mortalité importante ou d’apparition de maladies. Ce système permet non seulement de collecter des données essentielles sur la santé des populations, mais aussi d’identifier les causes de mortalité, qu’elles soient virales, fongiques ou d’une autre nature. Une telle réactivité est nécessaire pour limiter la propagation des pathologies et mettre en œuvre des mesures de gestion adaptées.
Dans cette optique, la veille sanitaire devient un outil clé pour la conservation des espèces prioritaires, notamment celles déjà menacées. À travers des dispositifs tels que la Surveillance de la Mortalité Anormale des Chiroptères (SMAC), les autorités et chercheurs suivent de près les signes de mortalité inexpliquée chez les populations de chauves-souris. Par ailleurs, des programmes d’épidémiosurveillance sont également mis en place pour surveiller des maladies spécifiques qui touchent ces animaux, comme la rage, la maladie du nez blanc (White Nose Disease), ainsi que pour mener des études en éco-épidémiologie sur les communautés de chiroptères.


L’épidémiosurveillance de la rage demeure particulièrement importante, car cette maladie virale peut affecter non seulement les chauves-souris, mais aussi d’autres mammifères, y compris l’homme. Parallèlement, la maladie du nez blanc, causée par un champignon, a fortement impacté les populations de chauves-souris en Amérique du Nord et pourrait se propager en Europe. Enfin, l’éco-épidémiologie permet d’étudier les interactions complexes entre les pathogènes, l’environnement et les populations de Chiroptères, afin de mieux comprendre les facteurs qui favorisent l’émergence de nouvelles maladies.
Ainsi, la surveillance active et l’étude des épidémies chez les Chiroptères sont des éléments essentiels pour anticiper les risques sanitaires et garantir la préservation de ces espèces fascinantes et bénéfiques pour la biodiversité. Grâce à ces dispositifs de suivi, il est possible de prendre des mesures rapides et adaptées pour limiter l’impact des maladies sur les populations de chauves-souris, contribuant ainsi à leur conservation à long terme.

Et concrètement ?
La formation des référents SMAC à la base de données Epifaune, hébergée par l’OFB, permet une forte réactivité en cas de mortalité, par la collecte de données et la détermination des causes des décès. Cette base facilite ainsi le suivi des incidents de mortalité et partage l’information entre tous les référents et les laboratoires d’analyses.
Veille sanitaire – Documents utiles
Éco-épidémiologie des communautés de chiroptères en France métropolitaine – 2018
Le projet « Éco-épidémiologie des communautés de chiroptères en France métropolitaine » étudie les dynamiques éco-évolutives des agents infectieux au sein des populations de chauves-souris en utilisant une approche pluridisciplinaire combinant génétique, virologie, bio-informatique et écologie comportementale. Il analyse les structurations génétiques des communautés, la diversité et la spécialisation des viromes, ainsi que les mécanismes de transmission intra- et interspécifiques des agents pathogènes. Grâce à des protocoles standardisés d’échantillonnage biologique (sang, fèces, ectoparasites) et des outils avancés de modélisation, le projet vise à caractériser les pressions de sélection hôte-parasite et à modéliser les patrons de circulation des pathogènes dans des contextes spatio-temporels variés. Ce travail contribue à la compréhension des processus évolutifs et à l’élaboration de stratégies de conservation pour les chauves-souris et de gestion des risques zoonotiques.
Signes visuels du syndrôme du nez blanc sur les chauves-souris en hibernation – Puechmaille – 2018

Remarquer et reconnaître le Pseudogymnoascus (Geomyces) destructans (Pd ou Gd) sur les chauves‐souris en hibernation. Responsable du syndrome du nez blanc chez les chauves-souris, il s’agit d’un champignon à croissance lente qui devient visible à partir de janvier, avec un pic de croissance en février-mars, selon les conditions régionales. Bien qu’il soit souvent associé au nez, il peut affecter d’autres parties du corps exposées, comme les ailes, les pieds et les oreilles. L’infection est parfois difficile à détecter, surtout à distance. Les chauves-souris Myotis myotis et Myotis blythii sont les plus touchées, suivies de Myotis dasycneme. Les infections chez d’autres espèces, comme les Rhinolophes, sont rares. Des images illustrent les profils d’infection, montrant les zones affectées encadrées en rouge.
Insecticides néonicotinoïdes et chiroptères : évaluation des risques directs et indirects – Canadian wildlife federation – 2018
Le rapport « Neonicotinoid Insecticides and Bats: An Assessment of the Direct and Indirect Risks » analyse les effets des insecticides néonicotinoïdes sur les chauves-souris au Canada, en évaluant les impacts directs (toxicité) et indirects (déclin des insectes, source de nourriture). Ces pesticides, largement utilisés en agriculture, contaminent l’environnement via le sol et les eaux de surface, entraînant une diminution significative des populations d’invertébrés, incluant des espèces aquatiques sensibles, essentielles à l’alimentation des chauves-souris. Le rapport souligne les risques accrus pour les chauves-souris en raison de leur régime alimentaire insectivore et de leur exposition prolongée aux résidus de pesticides présents dans les proies. Il propose une évaluation des risques basée sur la toxicologie des mammifères et les résidus dans les insectes, mettant en lumière les lacunes des méthodologies actuelles d’évaluation des pesticides pour ces espèces. Cette étude appelle à des approches plus spécifiques pour protéger les chauves-souris et les écosystèmes.
Labex ECOFECT – Éco-épidémiologie des Communautés de Chiroptères – 2016
Le projet dirigé par l’Université de Lyon cherche à mieux comprendre la biologie et l’écologie des chiroptères. L’objectif est d’identifier les agents infectieux, leur propagation et leurs impacts sur les populations. Les recherches se concentrent sur cinq thématiques : génétique, régime alimentaire, écotoxicologie, écologie du paysage et virologie, avec pour but de définir les structurations génétiques des populations et d’analyser les pressions environnementales et la circulation des agents infectieux.
Effets des substances chimiques sur les Chiroptères : état des connaissances – 2012
Ce document analyse les menaces posées par les substances chimiques sur les chauves-souris, mettant en évidence l’impact des pesticides tels que le DDT, les organochlorés (OC), les pyréthrinoïdes (PS) et les organophosphorés (anti-ChE). Il souligne un manque de données sur les effets chroniques et sublétaux de ces contaminants, particulièrement en Europe et dans les tropiques, malgré leur persistance environnementale et leur toxicité potentielle. Les lacunes incluent l’absence d’études sur les perturbations endocriniennes, les propriétés cancérigènes, et l’exposition aux radionucléides, bien que les chauves-souris puissent ingérer ces polluants via leur pelage ou leur alimentation. De plus, les effets indirects des polluants, tels que la diminution des proies due aux antiparasitaires ou aux pesticides agricoles, restent peu explorés. Le texte appelle à une approche pluridisciplinaire, inspirée de l’écologie du stress, pour évaluer les interactions entre pollution, maladies et contraintes environnementales sur les dynamiques de populations de chauves-souris.
Répartition pan-européenne du champignon responsable du syndrome du nez blanc non associé à une mortalité massive – 2011
Le rapport « Pan-European Distribution of White-Nose Syndrome Fungus (Geomyces destructans) Not Associated with Mass Mortality » explore la répartition du champignon Geomyces destructans responsable de la “white-nose syndrome” (WNS ou syndrôme du nez blanc) chez les chauves-souris en Europe. Contrairement à l’Amérique du Nord, où ce champignon est associé à une mortalité massive, en Europe, il ne provoque pas de décès significatifs, suggérant une co-évolution avec les espèces locales. L’étude confirme la présence de G. destructans dans plusieurs pays européens grâce à des analyses morphologiques et génétiques. Elle souligne que les spores du champignon, trouvées sur les parois des hibernacles, pourraient jouer un rôle de réservoir passif dans la transmission. Cette recherche fournit des données spatio-temporelles sur la dynamique du champignon et appelle à des études supplémentaires pour comprendre les différences pathologiques entre l’Europe et l’Amérique du Nord.
Ailleurs sur le web
Rabies in European bats – Eurobats – 2025
Le document « La rage chez les chauves-souris européennes » (édition 2024, révisée le 30.01.2025) contient des informations essentielles sur la rage des chauves-souris en Europe, expliquées en termes simples et scientifiquement solides.
Éclairage sur la réplication du SARS-CoV-2 dans des cellules de chauve-souris – Institut Pasteur – 2022
Des chercheurs de l’Institut Pasteur et du CNRS ont étudié la réplication du SARS-CoV-2 dans des cellules de chauve-souris, en utilisant des techniques d’imagerie en temps réel. Ils ont démontré une réponse immunitaire spécifique selon les espèces et les types de cellules. Ces résultats ont été publiés dans The Journal of Virology en juillet 2022.
Les chauves-souris, longtemps négligées en épidémiologie, ont suscité un intérêt croissant ces dernières décennies grâce à des découvertes sur leur écologie et leur rôle dans l’émergence de maladies. Cette synthèse présente leurs caractéristiques biologiques et les pathologies associées, établissant des liens entre ces deux aspects.
Schutz, Fanny – Étude épidémio-clinique des évènements de mortalité de chiroptères enregistrés par le réseau SMAC – Thèse d’exercice, Médecine vétérinaire, École Nationale Vétérinaire de Toulouse – 2020
La thèse évalue le réseau SMAC, lancé en 2014, pour la surveillance épidémiologique des Chiroptères. Un bilan épidémioclinique de la mortalité des chiroptères en France est présenté, accompagné d’une analyse du fonctionnement du réseau et de recommandations d’amélioration. Un état des connaissances sur les causes de mortalité est également fourni.